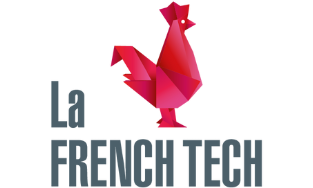Le syndrome mononucléosique est une affection d’origine virale, caractérisée par une triade symptomatique fréquente : fièvre, angine et adénopathie cervicale. Il est principalement causé par le virus d’Epstein-Barr (EBV), un herpèsvirus humain de type 4, mais peut également être lié à d'autres virus tels que le cytomégalovirus (CMV). Cette pathologie touche principalement les adolescents et les jeunes adultes, bien qu’elle puisse survenir à tout âge.
Qu’est-ce que le syndrome mononucléosique ?
Définition et origine virale
Le syndrome mononucléosique correspond à la réponse immunitaire de l’organisme à une infection virale, la plupart du temps due à EBV. Ce virus infecte initialement les épithéliums oro-pharyngés, puis les lymphocytes B, entraînant une prolifération lymphocytaire importante.
L’infection est très répandue : plus de 90 % des adultes présentent des anticorps spécifiques témoignant d’un contact antérieur. L’atteinte est généralement bénigne, mais la réponse immunitaire peut provoquer une symptomatologie marquée, notamment chez les patients non immunisés.
Symptômes les plus fréquents
Les manifestations cliniques du syndrome mononucléosique incluent une fatigue intense, une fièvre modérée à élevée, une pharyngite souvent sévère, et des adénopathies surtout cervicales postérieures. On observe fréquemment une splénomégalie (augmentation du volume de la rate) et parfois une hépatomégalie.
Des signes secondaires peuvent également apparaître : éruption cutanée, céphalées, douleurs musculaires et, plus rarement, jaunisse. L’intensité et la durée des symptômes varient selon l’âge et le statut immunitaire du patient.
Comment se transmet cette maladie ?
La transmission du syndrome mononucléosique se fait essentiellement par la salive, justifiant son surnom de "maladie du baiser". Le virus est excrété dans les sécrétions orales des sujets infectés, y compris après la phase aiguë. La période d’incubation est généralement comprise entre 4 et 6 semaines.
La contagiosité est élevée, en particulier chez les personnes immunodéprimées. La prévention repose principalement sur des mesures d’hygiène simples : éviter le partage de couverts, de verres ou tout contact salivaire avec des personnes symptomatiques.

Diagnostic et traitement du syndrome mononucléosique
Comment est posé le diagnostic ?
Le diagnostic du syndrome mononucléosique est avant tout clinique, mais il peut être confirmé par des examens biologiques. La numération formule sanguine montre typiquement une hyperlymphocytose avec présence de lymphocytes atypiques. Une cytolyse hépatique modérée est fréquente.
Les tests sérologiques permettent de confirmer la nature virale : recherche d’anticorps anti-VCA IgM (antigène de capside virale) et anti-EBNA (antigène nucléaire). Ces marqueurs permettent de différencier une infection aiguë d’une infection ancienne.
Quel traitement pour soulager les symptômes ?
Il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre le syndrome mononucléosique. La prise en charge est symptomatique : repos, antalgie par paracétamol ou ibuprofène, et hydratation adéquate. Les antibiotiques sont inutiles, sauf en cas de surinfection bactérienne confirmée.
La prescription d’amoxicilline est déconseillée dans ce contexte, car elle peut entraîner une éruption cutanée non allergique. En cas de complications (troubles respiratoires, atteintes neurologiques), une hospitalisation peut être nécessaire. Dans ce cas, consulter un Généraliste en Martinique, si vous y résidez, est essentiel pour un diagnostic et un suivi approprié.
Évolution et complications possibles
Dans la majorité des cas, le syndrome mononucléosique évolue favorablement en 2 à 4 semaines. Cependant, la fatigue peut persister plusieurs mois. Il est recommandé d’éviter les sports de contact pendant au moins 4 semaines en cas de splénomégalie, pour prévenir le risque de rupture splénique.
Des complications plus rares existent : hépatite aiguë, encéphalite, thrombocytopénie, ou syndrome de Guillain-Barré. Chez les patients immunodéprimés, EBV peut être à l’origine de proliférations lymphoïdes sévères, voire de lymphomes. Par ailleurs, la présence de bactéries d'estomac peut entraîner des complications digestives supplémentaires et nécessite un suivi médical.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il ne remplace pas une consultation médicale. En cas de symptômes persistants, consultez un professionnel de santé.